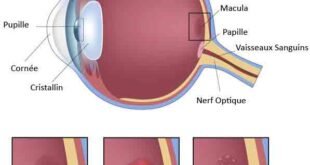Plante sacrée pour certains, fléau pour d’autres, le chanvre ou plus précisément Cannabis sativa n’a jamais cessé de faire parler de lui. En Haïti, on l’appelle souvent “ganga”, “djamba” ou tout simplement “mariwana”, selon les régions et les générations. Derrière ces surnoms familiers se cache pourtant une plante vieille comme le monde, dont l’histoire oscille entre usages spirituels, médicinaux, et polémiques modernes.
Né en Asie centrale, le chanvre aurait été domestiqué il y a plus de dix mille ans, bien avant le blé et le riz. Les premières civilisations s’en servaient pour tisser, se soigner et même prier. En Chine, on filait ses fibres pour fabriquer des vêtements et du papier ; en Inde, il entrait dans les rituels religieux et la médecine ayurvédique. En Europe, ses tiges servaient à confectionner les voiles des navires et les cordages des explorateurs. Rien d’étonnant à ce que la fameuse Bible de Gutenberg ait été imprimée sur du papier de chanvre une plante aussi utile qu’infatigable.
Mais le chanvre, ce n’est pas qu’une seule réalité. Il y a le chanvre industriel, légal et écologique, utilisé pour faire des tissus, du béton ou des cosmétiques. Et il y a le cannabis, celui qui contient du THC, la molécule psychotrope responsable de l’effet planant. D’un côté, la plante verte qu’on célèbre dans les salons de l’agriculture ; de l’autre, celle qu’on surveille dans les commissariats. Pourtant, au fond, c’est la même espèce. Seules les variétés et les taux de THC changent.
Dans la Bible, certains passages mentionnent une plante appelée qěnēh bośem, que plusieurs chercheurs identifient aujourd’hui comme une forme ancienne de cannabis. Elle aurait servi à préparer l’huile sainte utilisée pour oindre les prêtres et les objets sacrés. Une hypothèse fascinante, qui prouve à quel point cette plante a toujours eu un rapport étroit avec la spiritualité et la guérison.
Les scientifiques, eux, s’accordent à dire que le Cannabis sativa n’est qu’une grande famille aux multiples visages : indica pour les variétés relaxantes, sativa pour les stimulantes, ruderalis pour les plus rustiques. En tout, la plante produit plus de soixante cannabinoïdes, dont le THC (tétrahydrocannabinol) et le CBD (cannabidiol). Si le premier fait “planer”, le second soigne sans effet psychotrope. Aujourd’hui, le CBD est d’ailleurs devenu une petite star dans le monde médical et cosmétique.
En Haïti, comme ailleurs, le débat reste sensible. Le “ganga” est largement consommé, souvent dans un cadre récréatif ou spirituel, mais toujours en marge de la loi. La population en parle sans tabou, entre fascination et méfiance. Car si certains vantent ses vertus relaxantes, les médecins mettent en garde contre ses effets sur la mémoire, la concentration et la santé mentale, surtout chez les jeunes. Une consommation précoce peut perturber le développement du cerveau et mener à une dépendance psychologique réelle, même si la plante garde cette image “naturelle” qui rassure à tort.
Pourtant, ironie du sort, le chanvre pourrait bien redevenir une alliée de l’humanité. Les écologistes l’adorent : il pousse vite, nettoie les sols, ne demande presque pas d’eau et remplace avantageusement le coton ou le plastique. En Haïti, plusieurs projets pilotes explorent déjà son potentiel agricole, notamment dans la production de matériaux écologiques. Comme quoi, la plante que l’on diabolise pourrait bien redevenir, demain, un symbole d’avenir.
Widmie Ange Labossiere
 Echojounal echojounal.net
Echojounal echojounal.net